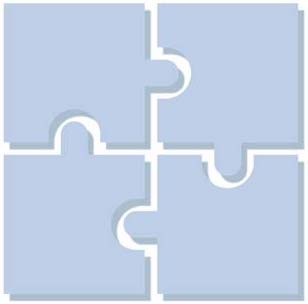Le laboratoire Sanofi a été reconnu responsable d’un manque de vigilance et d’information quant aux effets de la Dépakine sur les enfants à naître (TJ Paris, 5 janv. 2022, n°17/07001).
Le tribunal judiciaire de Paris a retenu début janvier 2022 que le laboratoire n’a pas assez prévenu et informé les femmes enceintes des risques de malformations et de troubles neuro-développementaux qu’engendre la Dépakine.
LIRE LA DÉCISION >> Tribunal judiciaire de Paris, 5 janvier 2022, n°17/07001
La Dépakine, un médicament à risque pour les femmes enceintes
Commercialisée depuis 1967, la Dépakine est prescrite aux adultes et aux enfants de plus de six ans afin de traiter différentes formes d’épilepsie. Ces médicaments ont été fabriqués et commercialisés en France par le laboratoire Sanofi à partir de 1979.
Si un consensus scientifique existe sur le fait que ce médicament est très efficace pour traiter l’épilepsie, des études ont rapidement démontré que celui-ci présentait des effets tératogènes, susceptibles de provoquer des malformations graves chez les enfants exposés in utero. Des études ont également indiqué que les enfants exposés présentent un risque accru de développer des troubles du développement et du comportement (retard moteur, du langage, spectre de l’autisme) et/ou des malformations congénitales (du visage, reins ou encore du cœur). Ainsi, les autorités publiques estiment que « jusqu'à 30 à 40 % des enfants d'âge préscolaire dont les mères ont pris du valproate pendant la grossesse présentent des problèmes de développement dans leur petite enfance. » (Base de données publique des médicaments, DEPAKINE 500 mg, comprimé gastro-résistant - Résumé des caractéristiques du produit). Aujourd’hui, la base de données publique des médicaments indique d’ailleurs que le composant de ce médicament, le valproate de sodium, est susceptible de « nuire gravement à l’enfant à naître s’il est pris pendant la grossesse ».
Si, depuis des années, des procédures individuelles sont menées au civil et au pénal pour reconnaître la responsabilité du laboratoire concernant les effets de la Dépakine, ce jugement constitue la première action de groupe recevable, non seulement à l’encontre de ce laboratoire, mais aussi en matière de santé publique.
LIRE AUSSI >> Du scandale de l’amiante à la consécration du préjudice d’anxiété
La première action collective de santé publique jugée recevable
En 2017, l’Association d’aide aux Parents d’Enfants souffrant du Syndrome de l’Anti-Convulsivant (l’APESAC) a demandé au laboratoire d’accepter sa responsabilité dans les préjudices corporels causés aux familles qu’elle représente et d’indemniser ces victimes.
Faute de réponse, l’APESAC a alors assigné le laboratoire et son assureur devant le tribunal judiciaire de Paris le 2 mai 2017 dans le cadre de la première action de groupe française en matière de santé publique.
Originaire des États-Unis, l’action de groupe permet aux personnes victimes d’un même préjudice causé par un professionnel de se regrouper et d’agir collectivement en justice. Cette procédure a été introduite en France par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon », et était initialement circonscrite au droit de la consommation. Puis, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a étendu son périmètre aux actions concernant les discriminations, la protection des données personnelles, l’environnement et la santé publique.
Ainsi, en matière de santé publique, l’article L.1143-2 du Code de la santé publique permet aux associations d'usagers du système de santé agréée d’agir en justice « afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles ». Ce recours permet ainsi à toute personne subissant un préjudice corporel causé par une faute liée à la production, à la fourniture, ou à la délivrance d'un produit de santé, d'être indemnisée grâce à l’action menée par l’association agréée.
En l’espèce, l’APESAC a saisi les juges parisiens afin de faire déclarer les conditions relatives à son action de groupe réunies et faire constater que le laboratoire a commis une faute de vigilance en commercialisant un produit défectueux entraînant diverses pathologies pour les enfants exposés in utero. De plus, l’association a soutenu que le laboratoire a manqué à son obligation d'information en omettant d’actualiser les notices de la Dépakine alors que la littérature médicale avait souligné ses risques.
En défense, le laboratoire a tout d’abord soulevé l’irrecevabilité de l’action de groupe initiée par l’APESAC. Il résulte des dispositions légales et de la jurisprudence que quatre conditions cumulatives doivent être réunies pour que l’action de groupe soit recevable : l’action doit être introduite par une association agréée d’usagers du système de santé (i), les usagers du système de santé doivent justifier de l’existence de préjudices corporels individuels (ii), le manquement invoqué doit être imputable à un producteur ou un fournisseur d’un produit de santé ou un prestataire utilisant le produit (iii) et, enfin, un lien de causalité entre les préjudices et le manquement doit être caractérisé (iv). Il a donc été demandé aux juges de vérifier la réunion de ces conditions de recevabilité.
Tout d’abord, les juges ont relevé que l’objet social de l’APESAC est de recueillir et de diffuser de l’information sur le syndrome de l'anti-convulsivant auprès des victimes potentielles ou avérées, ainsi que de leur famille, pour informer les praticiens sur l’existence de ce syndrome. De plus, cette association dispose bien d’un agrément national depuis 2016 pour représenter les usagers du service de santé. En deuxième lieu, les juges ont estimé que l’association justifie de façon satisfaisante l'existence des préjudices des quatorze familles qu’elle représente, sans qu’il n'y ait lieu à ce stade de la procédure d'apprécier le droit à indemnisation de chacune d’elles. S’agissant de la situation similaire ou identique des usagers, le tribunal a relevé que les usagers sont « de femmes qui ont pris un tel traitement médical entre 1970 et 2016, et qui demeurent dans toute la France » (jugement p.15) et qu’on « peut donc considérer que ces femmes sont placées dans une situation similaire ou identique et que ces situations sont particulièrement représentatives » (jugement p.15). Enfin, le tribunal a considéré que le « lien de causalité entre les manquements et les préjudices […] ne s’apprécie pas au niveau de la recevabilité de l’action mais au niveau du bien-fondé de cette action » (jugement p.15).
Toutes les conditions de recevabilité de l’action de groupe en matière de santé publique étant satisfaites, le tribunal a estimé que celle-ci était recevable.
Après que les juges ont rejeté les demandes procédurales du laboratoire tenant à écarter des débats un rapport d’expertise réalisé dans le cadre de l’instruction pénale, à solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la décision au pénal ainsi qu’une réouverture des débats, les juges se sont penchés sur la question de la prescription pour les enfants exposés avant 1998.
LIRE AUSSI >> L’affaire Erika : la naissance du préjudice écologique
La fixation du délai de prescription pour les enfants exposés avant 1998
S’agissant de la responsabilité pour faute du laboratoire pour les enfants exposés au médicament avant le 22 mai 1998, l’APESAC a estimé qu’il incombait au laboratoire de se tenir informé des effets secondaires du produit qu’il commercialisait, et, qu’en ne réalisant pas des études, en ne mettant pas en place des mesures visant à faire cesser les risques, ou encore en ne délivrant pas une information complète aux médecins prescripteurs, le laboratoire a manqué à son obligation de vigilance.
En défense, le laboratoire et son assureur ont tout d’abord invoqué la prescription de l'action en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ces faits remontant à plus de 30 ans. Les juges ont reconnu qu' « à l’époque la prescription de droit commun était une prescription trentenaire. À compter de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun est passé de 30 ans à 5 ans selon le nouvel article 2224 du code civil » (jugement p.20). Ainsi, l’action en responsabilité se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’agissait alors de déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour faute. Rappelant une jurisprudence récente de la Cour de cassation au sujet de la Dépakine, les juges ont retenu que le point de départ de la prescription de droit commun « ne commence à courir qu’au jour où les demandeurs ont eu connaissance de la nature et de l’origine des dommages présentés par les enfants exposé in utero au Valproate de sodium, à la suite d’investigations et d’expertises médicales » (jugement p.20, Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 27 novembre 2019, n° 18-16.537) Par conséquent, le point de départ du délai de prescription a été judiciairement fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise médicale générale ordonné lors de l’instruction pénale, soit au 20 janvier 2020. Dès lors, pour les juges, « l’action de groupe initiée par l’APESAC sur le fondement de la responsabilité pour faute sur le fondement des articles 1382 et 1240 du code civil n’est pas prescrite » (jugement p.21).
Cette question procédurale ayant été écartée, les juges se sont penchés sur le fond du droit, à savoir les questions de responsabilité du laboratoire.
Le manquement du laboratoire à son obligation de vigilance et d’information
Dans ses demandes, l’APESAC a invoqué à la fois un manquement du laboratoire à son devoir de vigilance, ainsi qu’à son devoir d’information afin d’engager sa responsabilité pour faute.
Le rapport d’expertise de 1 200 pages sollicité dans le cadre de l’instruction pénale a confirmé les études médicales publiées au sujet de la Dépakine depuis plusieurs années, à savoir les risques tératogènes que comporte le médicament, ainsi que les troubles neuro-développementaux qu’il occasionne. De plus, selon les experts, la tératogénicité du produit pouvait être qualifiée de probable à partir de 1984, tandis que les risques de malformations majeures pouvaient étaient recensés depuis les années 1990-1992 et depuis 2008-2009 s’agissant des troubles du comportement.
Ainsi, les juges ont considéré que le laboratoire « aurait dû, dès 1984, solliciter la modification de la notice des médicaments […] auprès de l’agence nationale de sécurité du médicament afin de donner une information […] précise conforme aux données acquises de la science aux professionnels de santé, aux patients et au grand public, ce qu’il n’a pas fait. » (jugement p.28). Or, « ce n’est qu’en 2006 que le texte de la notice indique que la grossesse est déconseillée. Ainsi, les notices éditées avant cette date ne sont donc pas conformes aux données de la science, depuis plusieurs années » (jugement p.28). Dès lors, « les notices du médicament n’ont pris en compte les données de la science que tardivement et de façon incomplète » (jugement p.28).
LIRE AUSSI >> L’arrêt Perruche : le prix du handicap
Par conséquent, le tribunal a considéré que le manquement du laboratoire à son obligation de vigilance renforcée et à son obligation d’information concernant les risques de la Dépakine constitue une faute au sens des articles 1382 ancien et 1240 du Code civil.
La caractérisation de la défectuosité du médicament
Selon le laboratoire, les demandes de l’APESAC concernant les enfants exposés à des médicaments mis sur le marché à compter du 30 juillet 1988 sont nécessairement fondées sur le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants du Code civil). Or, le laboratoire a estimé que le délai de 10 ans prévu par ces dispositions n’est pas un délai de prescription, mais un délai d’extinction de la responsabilité du producteur, et, qu’en outre, il n’a pas commis de faute.
Au contraire, l’APESAC a soutenu que la date de mise en circulation fixe le point de départ du délai d’extinction de l’action en réparation et qu’il appartient au laboratoire de rapporter la preuve de la mise en circulation du produit. Faute de justification de cette date de mise en circulation du produit qui a causé le dommage, aucun délai d’extinction ne pourrait lui être opposé. De plus, elle a allégué qu’en matière de médicament, le délai de forclusion décennal empêche toute action dans les cas où les troubles apparaîtraient au-delà du délai de 10 ans, et constitue une atteinte à son droit fondamental d’accès à un tribunal.
Concernant la possible forclusion de l’action, les juges ont retenu qu’en effet, aux termes de l’article 1245-15 du Code civil, « sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci […] est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice » (jugement p.30). Toutefois, le tribunal a rappelé que le laboratoire « a commis une faute de vigilance, laquelle fait obstacle à l’application du régime d’extinction de la responsabilité à compter d’un délai de dix ans après la mise en circulation du produit qui a causé le dommage » (jugement p.30). Par conséquent, la faute de vigilance commise par le laboratoire fait obstacle à l’application du régime d’extinction de la responsabilité à compter d’un délai de dix ans après la mise en circulation du produit qui a causé le dommage.
En défense, le laboratoire a ensuite allégué que la réunion des trois conditions d’application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, à savoir la démonstration d’un défaut (i), d’un dommage (ii) et d’un lien de causalité entre les deux (iii), n’étaient pas réunies.
S’agissant du dommage, le tribunal a retenu que la littérature médicale a bien établi que l’exposition à ce médicament in utero est associée à un risque accru d’anomalies du développement du fœtus. De plus, étant donné que d’autres médicaments étaient disponibles pour traiter l’épilepsie, les juges ont caractérisé l’existence d’une perte de chance de 95 % pour les femmes enceintes à l’époque de se voir prescrire un autre traitement moins risqué.
Puis, concernant le lien de causalité, les juges ont considéré que la littérature médicale présente des indices factuels graves, précis et concordants sur l’existence d’un défaut du médicament et qu’il existe donc « une corrélation objective entre le taux très élevé de malformations et de troubles du développement et l’exposition in utero au médicament litigieux » (jugement p.34). En outre, l’article L.1142-24-12 du Code de la santé publique pose depuis 2017 une présomption d’imputabilité des effets indésirables du valproate de sodium à un manque d’information des patientes. En revanche, pour les juges, ces études ne permettent pas d’établir avec certitude un lien de causalité entre le défaut allégué du médicament et l’existence de troubles du spectre de l’autisme.
S’agissant du défaut du médicament, l’article 1245-3 du Code civil dispose qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, notamment compte tenu de la présentation du produit dans sa notice. Or, le tribunal a estimé que la notice destinée aux patients ne listait pas de façon suffisamment claire et précise le risque tératogène élevé, ni celui de développer des troubles développementaux et cognitifs, et ce, jusqu’à la demande de modification de la notice de janvier 2006.
Par conséquent, le tribunal a retenu que le produit ne présentait pas la sécurité à laquelle les patients pouvaient s’attendre du 22 mai 1998 au 25 janvier 2006 inclus pour les effets tératogènes et de janvier 2001 au 25 janvier 2006 inclus pour les troubles développementaux et cognitifs, si bien que celui-ci était défectueux.
Enfin, les juges ont rejeté la demande d’exonération de responsabilité du laboratoire au motif qu’il aurait suivi les règles sanitaires impératives, estimant qu’obtenir un agrément de commercialisation ne suffisait pas, puisque celui-ci était « tenu d’assurer une véritable veille sanitaire de pharmacovigilance et devait, dès lors, avoir eu connaissance d’effets indésirables lors de la grossesse de l’utilisatrice, et faire modifier en ce sens les informations destinées aux utilisatrices ainsi qu’aux professionnels de santé » (jugement p.46).
Ainsi, les juges ont retenu une présomption simple de causalité entre l’exposition à la Dépakine durant la grossesse et les pathologies présentées par les enfants et accepté une indemnisation des victimes.
« Cette décision comporte certaines difficultés, notamment en raison des dates retenues pour établir la responsabilité de SANOFI qui sont trop restrictives et ne sont pas conformes aux données de la science. Ainsi, le législateur avait lui-même reconnu des dates plus élargies pour le fonctionnement du dispositif ONIAM [l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux] spécialement créé pour les victimes de la Depakine. Ces questions feront l’objet de débats lors de la future procédure d’appel. » - Charles Joseph-Oudin, associé au sein du cabinet Dante Avocats et conseil de l’APESAC.
La mise en œuvre de l’action de groupe
Afin de permettre aux adhérents de l’APESAC de se faire représenter par elle pour être indemnisés, le tribunal a prévu un délai d’adhésion au groupe de cinq ans à compter du prononcé du jugement le 5 janvier 2022. Ainsi, les femmes ayant été enceintes en France entre 1984 et janvier 2006, les enfants exposés in utero pendant cette période, ainsi que toute victime indirecte peuvent adhérer au groupe d’usagers du système de santé. Néanmoins, si les juges ont fixé la période durant laquelle le risque de malformations congénitales n’a pas suffisamment été pris en compte entre 1984 et 2006, ils ont réduit cette période à 2001-2006 pour les troubles neurodéveloppementaux, ce qui exclut une large partie des victimes potentielles.
Le laboratoire a fait appel de ce jugement. La présidente de l’APESAC a également déclaré souhaiter faire appel de ce jugement pour contester la reconnaissance des enfants victimes de troubles du comportement uniquement à partir de 2001 (Communiqué de presse de l’APESAC du 11 janvier 2022). Il faudra donc attendre une décision d’appel afin de savoir si l'action de groupe pourra finalement s'ouvrir.
«La position adoptée par le tribunal judiciaire de Paris n'est pas en adéquation avec les premières décisions de justice qui, soit ne retiennent pas la responsabilité du laboratoire, soit constatent que la responsabilité prépondérante repose sur d'autres acteurs du système de santé.» - Communiqué de presse de Sanofi cité dans Le Monde.
Si ce jugement est susceptible d’avoir des retentissements sur les autres procédures engagées contre le laboratoire, la saga judiciaire de la Dépakine est loin d’être finie. En effet, le laboratoire a aussi été mis en examen en 2020 dans le volet pénal du dossier et fait face à de nombreuses plaintes individuelles. En outre, une procédure est en cours contre l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), lui reprochant de ne pas avoir correctement joué son rôle de gendarme. La faute de l'État a d’ailleurs aussi été retenue en juillet 2020 par le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 2 juill. 2020, req. n° 1704275)
« Cette décision a une portée symbolique importante et sanctionne la stratégie du laboratoire qui a d’ores et déjà fait savoir qu’il allait faire appel de cette décision. » - Charles Joseph-Oudin, associé au sein du cabinet Dante Avocats et conseil de l’APESAC.
Retrouvez l'intégralité des chroniques judiciaires en cliquant sur ce lien.

Diplômée de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de Sciences Po, Calypso rédige des contenus pour le Blog Predictice.